Ça n’est pas de ta faute.
Sûrement pas non plus celle de ta chatte si avide de ma queue.
Pas non plus celle de ta bouche qui réclamait la mienne.
Pas non plus celle de ton cul que tu m’as offert avec le reste — si, si, Monsieur, vous pouvez aussi visiter cette pièce.
Ça n’est pas de ta faute.
Sûrement pas celle de nos rendez-vous du dimanche quand nous allions au cinéma (c’était autre chose que Le film du dimanche soir à la télé), nous tripotant comme des adolescents (ou plus précisément, rattrapant enfin le temps perdu de nos adolescences solitaires, il n’est jamais trop tard) lorsque le film ne nous captivait pas assez.
Pas non plus celle de nos déjeuners du mardi, très sages, où l’on discutait boulot, politique, cul et sens de la vie ; des morceaux de temps qui faisaient presque de nous un couple ordinaire.
Pas non plus celle de nos rendez-vous improvisés, qui me donnaient l’impression d’être un gamin qui file en cuisine voler du rab’ de dessert.
Ça n’est pas de ta faute.
Non, sûrement pas celle de ton corset que j’aurais voulu t’offrir, mais que tu as tenu à payer de tes deniers ; j’aimais son rouge sombre ; j’aimais tirer sur les lacets jusqu’à ce que tu me dises c’est assez (c’est drôle, non ? corset, baleines, cétacé. C’est pour détendre l’atmosphère).
Pas non plus la faute de ce vibromasseur avec lequel je t’ai fait jouir plusieurs fois. J’aimais être la main de ce plaisir qui aurait pu être solitaire.
Pas nous plus celle de ce gode violet que je t’avais demandé d’enfoncer vivement dans mon cul, impatient que j’étais que tu me violentes, impatience que je vais encore devoir ravaler … jusqu’à quand ?
Ça n’est pas de ta faute.
Vraiment pas non plus la faute de ces messages qu’on échangeait sans arrêt. Des SMS qui me démangeaient les pouces dès que j’avais un instant à voler et que mon cerveau pensait à toi — c’est à dire souvent.
Pas la faute de ces photos et ces petites vidéos indécentes que nous avons pris ensemble.
Pas la faute de ces deux soirées que nous avons passées à trois, ni tous ces autres fantasmes que nous aurons eut le temps de mettre en scène, avec gourmandise et joie lubrique.

Non, c’est ma grande faute à moi, ma maxima culpa.
Ma faute d’avoir creusé à coup de bite depuis 6 ans la tombe de mon couple — et aujourd’hui encore je ne sais pas si je veux rester vivant ou m’enterrer avec.
Ma faute d’avoir pensé qu’on pouvait jouer impunément avec ses amantes, juste pour combler ce manque d’érotisme dont je pâtissais depuis 7 ans, que ça ne ferait que rééquilibrer ma vie, et rien d’autre. Ma faute de ne pas m’être rendu compte qu’avec toi, ce n’était pas seulement différent des autres en intensité, mais qu’intrinsèquement, c’était différent ; contrairement aux autres, tu n’étais pas une femme en couple à la recherche, comme moi, de frisson, mais une célibataire qui attendait l’amour — et je t’en ai donné. Ma faute d’avoir pensé que vouloir que ce soit possible suffise pour que ça le soit.
Ma faute si maintenant je me retrouve face à ce grand vide, à la croisée des chemins.
Mais quel chemin emprunter quand on est persuadé que celui du bonheur est désormais derrière soi ?
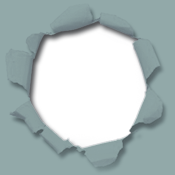



 J’aurais même pu en mettre trois, ou quatre, ou cinq, ou plus mais il me manquait les affinités.
J’aurais même pu en mettre trois, ou quatre, ou cinq, ou plus mais il me manquait les affinités.
 Depuis un peu moins de 20 ans, je donne régulièrement mon sang.
Depuis un peu moins de 20 ans, je donne régulièrement mon sang.