Avant de lire la seconde histoire, merci de passer jeter un œil à l’introduction, puis à la première histoire.
O et son double
Aujourd’hui, O est seule chez elle. Son amant l’a appelé, mais elle a prétexté une gastro (très efficace, très dissuasif la gastro comme alibi) pour rester seule avec elle-même.
Peut-être recommencera-t-elle demain.
Elle prend un long bain, trop chaud, mais elle ne peut pas s’en empêcher, et s’amuse avec un galet effervescent qu’elle a coincé sous la naissance de ses cuisses. Une caresse, une chatouille, à peine perceptible… Elle s’abandonne lascive, dans ses pensées, ouvrant les yeux, les fermant parfois… Elle se remémore quelques moments passés avec son amant, sa rencontre avec lui, un jour où pourtant elle était particulièrement remontée contre la gent masculine ; il avait su faire preuve d’une douceur si surprenante.
Parfois sa main s’aventure sur son corps. Entre savonnage et caresse, parfois elle se caresse le sexe, pour aviver la piqûre de certains souvenirs, mais elle ne s’abandonne pas à son plaisir, le laisse décroître, et continue sa promenade dans ses pensées.
Elle pense aussi à Pierre, son amant précédent. En réalité, il y en avait eu un autre dans l’intervalle, mais tellement pitoyable, O ne veut même pas y penser. Pierre avait été une parenthèse magique dans son existence, trop courte. Mais elle le savait dès le départ. Pierre avait révélé en elle un pouvoir et des envies qu’elle aurait farouchement repoussées de la main si on lui en avait parlé seulement un mois avant sa rencontre avec Pierre. (Un peu comme votre serviteur : « moi, voter Chirac ? et pis quoi encore ? » — ben encore : avec une procuration, donc deux fois mon coco — Ca va les mecs, ne débandez pas je continue ;-) [Eh oui, ce texte date de 2002, NDLR]
O sort de son bain, un peu troublée par les rivages où ses rêves l’ont fait échouer, contemplant le chemin parcouru par elle en si peu de temps. Sa vie sexuelle était passé d’une suite de moments plus ou moins roses — ou moroses — selon la qualité de ses amants, à un torrent de découvertes qui l’emportait, lui faisait mal, la sublimait…
Elle enfile son peignoir, s’essuie à peine les jambes, et se rend à son salon. Quelques gouttes d’eau tachettent sa moquette ; elles sécheront vite.
Elle glisse dans sa platine un ancien CD des Cocteau Twins, et s’allonge sur son canapé pour poursuivre ses rêveries.
O choisit de se rappeler sa découverte du bondage. Un jour, son amant lui avait bandé les yeux. Jusque là, O ne savait pas jusqu’où ce jeu allait l’amener. Les yeux bandés, elle connaissait, elle avait d’ailleurs souvent eu l’occasion de vivre cette situation où, privée de la vue, elle voyait (!) ses autres sens exacerbés. En premier lieu, le toucher. Chaque caresse, venue d’on ne sait où, surprend comme un fer rouge. L’ouïe également, l’oreille aux aguets pour savoir où se trouve l’ennemi, essayer de deviner où il va frapper ! Mais cette fois-ci, O, les yeux bandés, n’avait pas deviné ce qui allait lui arriver. Son amant l’avait couchée sur le lit, et l’avait embrassée, caressée… Elle aussi l’embrassait, mais à chaque fois qu’elle voulait poser ses mains sur son corps d’homme, il les repoussait brutalement…
Puis, quand il avait senti que son excitation était assez grande (en fait, O avait cette faculté à ne laisser aucune ambiguïté sur la force de son désir, son sexe était vite très très humide), il avait saisi ses poignets et les avaient noués d’un foulard. Les foulards étaient doux, mais le nœud était serré.
Les mains entravées, O avait entendu son amant s’affairer dans le placard et se demandait avec un mélange de crainte et d’excitation ce qu’il aurait dans les mains en revenant…
Pendant qu’O se laisse aller à cette rêverie rétrospective, elle promène sa main sur son corps. Son peignoir bâille largement, découvrant un de ses seins, et comme elle avait les jambes un peu écartées, son sexe est lui aussi ouvert à tous les regards — malheureusement, personne à part O, pour profiter du spectacle.
O fait avancer sa main sur son ventre. Elle ne s’attarde pas sur son pubis lisse. Parfois, elle regrette de ne plus pouvoir promener ses doigts dans sa toison, brune, abondante, mais son amant l’a astreinte à l’épilation totale. Son sexe n’est plus tout à fait le même ainsi. Comme s’il avait changé de personnalité. Elle ne s’attarde pas sur son pubis, donc, et atterrit vite sur son sexe. D’abord, de la pointe du majeur, elle frôle de haut en bas, puis de bas en haut, ses deux grandes lèvres, effleure le clitoris, puis plus violemment elle plonge son doigt (instant majeur !) en elle. Alternant l’intensité de ses caresses, elle reprend le fil de son souvenir.
O sentit alors que son amant glissait entre ses poignets une corde. Quelques tours, puis un nœud. Il lui leva les bras, et ses mains désormais touchaient les barreaux du lit. Presque par réflexe, elle les empoigna, et c’est dans cette position que son amant lui ligota ses mains aux barreaux du lit. O ne pouvait plus les bouger. Son amant avait astucieusement serré les liens ; suffisamment lâches pour que le sang circule, mais dès qu’elle faisait mine de vouloir s’en libérer, l’entrave était complète. Avec une autre corde, l’amant enserra ensuite sa cheville (non sans l’avoir auparavant embrassée), qu’il attacha à l’autre bout du lit, puis inévitablement l’autre jambe connut le même sort.
Si ses bras étaient l’un contre l’autre, ses jambes étaient en revanche, bel et bien écartées, et O fut un instant honteuse d’offrir ainsi son sexe ouvert, bien qu’elle n’aurait en aucune façon pu adopter une pause moins indécente.
O sentit ensuite les mains de son amant parcourir son ventre, ses jambes, ses bras, sa nuque. Il avait des mains à la fois fines et puissantes, O les avait remarquées dès sa rencontre ; à l’œuvre sur son corps, elles tenaient toutes les promesses qu’O avait imaginées d’elles. Tout son corps était caressé, sauf son sexe, pourtant il appelait le contact. O mouillait. O voulait qu’un doigt, une main, un sexe, comble ce vide, vite. Mais l’attente continuait, la fièvre montait, O avait envie de crier « prends moi ! baise moi ! »… Bientôt ce fut la bouche de l’amant qui se joignit au ballet de ses mains, mais toujours fuyant l’origine du monde, malgré quelques passages en haut des cuisses, là où la peau est si douce et si vibrante.
Au moment même où O se souvient du premier contact de la bouche de son amant sur son corps immobile, elle est foudroyée par son premier orgasme qui part comme un spasme de son ventre pour remonter jusqu’à l’échine. Elle regarde sa main, elle a presque l’impression que ce n’est plus elle qui la pilotait tandis que défilait dans son crâne le film de cette nuit fondatrice. Elle constate presque honteuse que son con a englouti quatre de ses doigts. Sa cyprine fait briller ses jambes jusqu’à mi cuisse… Elle fait une petite pause dans ses souvenirs, se caresse encore, et s’offre rapidement un deuxième orgasme, moins intense, mais plus doux, plus prolongé.
Le disque des Cocteau Twins est terminé. O se lève, et met sur sa platine le premier album d’Archive, un sublime sirop à souvenirs languissants… Puis elle va farfouiller dans un tiroir où elle réunit, oui, au salon, pas dans sa chambre ! quelques objets offerts par ses différents amants. En matière de petits cadeaux, c’était Pierre qui s’était montré le plus prolixe, et le plus imaginatif aussi ! Elle se saisit ainsi d’un minuscule vibreur qui se met au doigt comme une bague, le rendant bio-nique, comme s’amusait à dire son amant. Elle s’allonge de nouveau, allume le gadget qui se met à bourdonner comme une mouche. Elle en apprécie à nouveau la caresse et reprend le fil de son souvenir…
Écartelée sur le lit, livrée aux caresses de son amant, O avait non seulement les nerfs à fleur de peau, chaque baiser étant comme une brûlure, mais également le cerveau à vif, l’imagination au grand galop qui explorait l’étendu des possibles, cherchant à anticiper son sort, se trompant toujours.
Les caresses s’interrompirent. O retint son souffle.
Son amant prit un foulard et la bâillonna. Elle était aveugle. Désormais elle serait aussi muette.
Elle tressaillit en entendant ce qui lui avait bien semblé être le bruit d’un briquet qu’on allumait.
Puis quelques instants de silence. Elle lança une petite plainte, étouffée, d’inquiétude. « Ushhhhh » intima l’amant.
Elle se cambra de douleur et de surprise quand la première goutte de cire tomba sur son ventre. Elle voulut crier, mais elle ne put émettre qu’une sourde plainte. Deuxième goutte. Nouvelles contorsions. Son amant avait alors resserré le bâillon, retendu les cordes qui l’immobilisaient. Troisième goutte. La douleur, toute aussi vive, avait malgré tout changé de nature. La douleur était devenue pulsation. Comme si, à l’endroit même où la goutte avait atterri, battait tout son sang. Quatrième goutte… Cinquième goutte. Son cœur lui même semblait s’être déplacé juste sous le point d’impact. Les seins d’O furent épargnés. Et son amant, même s’il avait, à dessein, fait progresser les impacts chaque fois plus bas sur le ventre d’O, s’était arrêté en haut du pubis. Nouvel orgasme sur le canapé.
O sentait son ventre entier palpiter. C’est à ce moment là qu’elle sentit le sexe de son amant s’introduire en elle. O, sans pouvoir se contrôler, se mit à pleurer. Sans le bandeau qui les absorbait, de grosses larmes auraient coulé sur ses joues. Elle pleurait, son corps secoué de spasmes, tandis que son amant allait et venait en elle sans sembler s’en soucier… Pleurs de douleurs, pleurs de joie, pleurs de plaisir, pleurs de folie. Elle pleurait et sentait monter en elle le plaisir… Son amant venait de lui retirer le bâillon, elle ne poussait plus de cris mais des petits gémissements, quelques sanglots, puis un cri de jouissance… Son amant, ce soir là, ne jouit pas en elle. Il l’embrassa. Elle lui dit « je t’aime » (et pourtant, ce vocabulaire-là, comme il était interdit entre eux !!!), il lui répondit « ushhhh » à nouveau, tandis qu’il défaisait ses liens.
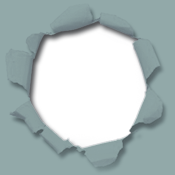

 Sur les écrans, un film d’angoisse.
Sur les écrans, un film d’angoisse. Même ce tableau là ►►► il est inspiré de la réalité.
Même ce tableau là ►►► il est inspiré de la réalité.